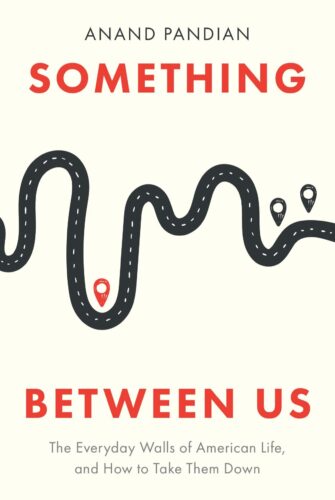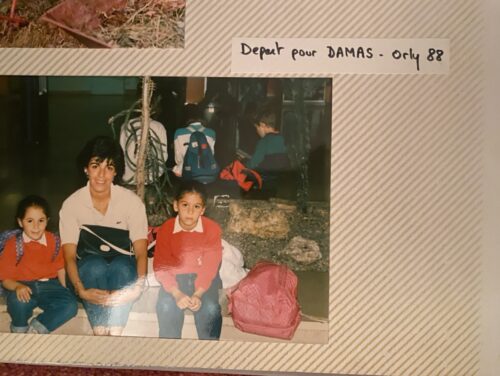Surveillance et suspicion depuis les marges

J’ai frappé plusieurs fois à la porte de Marta. Je lui apportais des cadeaux : des paquets de couches pour sa petite fille qui venait de naître. [1] [1] Les noms des interlocuteurs ont été modifiés afin de protéger leur vie privée.
La musique forte qui jouait à l’intérieur l’empêchait probablement d’entendre mes coups. Je me suis assis sur un tas de vieux pneus, attendant devant sa maison à la périphérie de Santiago, au Chili.
Un voisin, debout sur le seuil de sa porte d’entrée, m’a aboyé : « Qui cherches-tu, mon ami ? »
« Marta. »
« Marta ? Il n’y a pas de Marta ici », a-t-il déclaré catégoriquement.
« Elle vit là. » Tournant la tête, j’ai regardé la maison de Marta, construite à partir de palettes et de tôle.
Le voisin a répondu : « Je te tiens à l’œil. » Il a vaguement pointé du doigt un endroit derrière le portail où une caméra de surveillance était installée.
En tant qu’anthropologue, j’étudie la politique des personnes en situation précaire. Ces recherches m’amènent souvent dans des endroits en apparence dangereux, tels que des frontières contestées et des quartiers contrôlés par des gangs criminels. Dans ces cas-là, je m’attends à courir des risques et à être traité avec suspicion.
Mais Marta—une migrante vénézuélienne avec laquelle je me suis lié d’amitié pendant mon travail de terrain—vivait dans un campamento, un quartier informel construit par les habitants après avoir occupé des terrains abandonnés. En raison de la pénurie de logements et des loyers élevés, de nombreuses personnes au Chili vivent dans des campamentos. Parallèlement, les personnes qui ne vivent pas dans ces campamentos stigmatisent ces quartiers comme étant dangereux et échappant au contrôle de l’État.
Compte tenu de l’esprit communautaire qui règne dans les campamentos, je pensais que les habitants me considéreraient comme un allié dans leur lutte pour le logement, même si je suis vénézuélien et noir—deux caractéristiques associées à l’appartenance à des gangs criminels, selon les stéréotypes répandus au Chili. J’avais tort.
Même dans des endroits à la marge comme les campamentos chiliens, l’augmentation de l’immigration a alimenté la xénophobie et la discrimination. La méfiance et la surveillance dont j’ai fait l’objet illustrent une tendance mondiale où la peur l’emporte sur la liberté et le souci des besoins fondamentaux. En tant qu’anthropologue, je me suis demandé ce que l’on perd lorsque la protection contre « les autres » devient la principale préoccupation d’une communauté.
TON PAYS, MON PAYS
Selon les dernières estimations du Service national chilien des migrations, sur une population totale de migrants au Chili légèrement inférieure à 2 millions, plus de 700 000 personnes viennent du Venezuela—ce qui représente près de 40 % de tous les étrangers dans le pays. De nombreux Chiliens reprochent aux Vénézuéliens d’être responsables de crimes et de rendre le pays dangereux. En conséquence, les migrants vénézuéliens sont devenus la cible d’actes xénophobes, notamment d’expulsions violentes, de passages à tabac par la police et d’incendies criminels allumés par des manifestants anti-migrants.
Le racisme est à l’origine de cette discrimination : comme l’ont montré des études, de nombreux Chiliens se considèrent comme blancs et se méfient des immigrants à la peau plus foncée venus de Colombie, d’Haïti et du Venezuela.
Christopher—un migrant haïtien au Chili et l’un de mes plus proches collaborateurs—se plaignait souvent de la méfiance des autres à son égard. Il pensait que je le comprenais parce que « nous sommes noirs ».
Je lui ai dit que je ressentais moi aussi cette méfiance dans le campamento.
Après s’être excusé, il a ajouté : « C’est juste que les gens de ton pays—pas tous, pas toi, mais certains—ont fait de mauvaises choses. C’est partout dans les médias et sur les réseaux sociaux, mon gars. »
Marta avait le même avis : « Tu sais comment c’est. Ce n’est pas nous tous. C’est juste certains. » Comme moi, elle est vénézuélienne. Mais elle n’est pas noire.
Comme beaucoup de Chiliens, Christopher et Marta avaient vu des reportages sur des Vénézuéliens commettant des crimes. Les médias aimaient particulièrement se concentrer sur le Tren de Aragua, un gang criminel violent originaire du Venezuela qui s’est étendu au Chili, au Pérou, en Colombie et, selon certaines informations, à certaines villes des États-Unis. Le gang se livre à la traite d’êtres humains, au trafic de drogue, à l’extorsion et au meurtre afin d’établir un contrôle social sur les communautés pauvres.
L’expansion du Tren de Aragua au-delà du Venezuela a incité certains gouvernements à adopter des politiques réactionnaires, telles que l’expulsion et l’emprisonnement injustifiés de Vénézuéliens par le gouvernement étatsunien. Ces mesures ont détruit la vie de nombreuses personnes innocentes.
CHAÎNES DE SUSPICION
Dans les campamentos, j’ai étudié comment les migrants organisent leur vie ensemble, compte tenu de leurs origines nationales divergentes. Informels et précaires, les campamentos sont nés de l’occupation de terrains abandonnés, qui n’étaient pas autorisés par l’État pour la construction de bâtiments ou de logements. Beaucoup de leurs résidents étrangers sont considérés comme « illégaux » par l’État chilien. Par conséquent, l’État, les médias et de nombreux Chiliens qui ne vivent pas dans les campamentos décrivent généralement ces quartiers comme « hors-la-loi ». Les habitants des campamentos se plaignent souvent que chaque fois qu’un crime est commis à proximité, la police les considère immédiatement comme les auteurs présumés.
Je prévois un monde où la suspicion envers la différence et les autres se manifestera à tous les niveaux.
J’ai donc été surpris de constater que les habitants des campamentos se méfiaient également des étrangers qui entraient dans leur communauté.
Dans le campamento où vivent Marta et Christopher, chaque fois que je discutais avec Claude, un commerçant haïtien, il se contentait de passer la tête par la fenêtre, protégée par un grillage métallique.
Lors de notre première rencontre, il m’a demandé : « Que faites-vous ici ? »
Sans me laisser répondre, il a ajouté : « C’est rare que quelqu’un de votre pays vienne ici pour poser des questions. »
La méfiance de Claude provenait d’un mélange de ragots, de désinformation et de faits concernant la responsabilité des Vénézuéliens dans des actes criminels et l’insécurité au Chili, diffusés par les médias et les réseaux sociaux.
Claude avait également installé une caméra pointée vers les clients de son magasin. Les caméras dans les campamentos de Santiago s’inscrivent dans une tendance mondiale qui consiste à utiliser des équipements de surveillance pour prévenir la criminalité au niveau communautaire. Les caméras se sont généralisées et sont désormais utilisées non seulement dans les bâtiments gouvernementaux, les entreprises et les banques, mais aussi dans les maisons des particuliers.
Lorsque j’ai discuté avec les habitants du campamento au sujet des caméras, ils ont exprimé leur inquiétude et leur besoin de protéger leurs familles. Je comprends et je compatis.
Mais la surveillance citoyenne peut être une arme à double tranchant. Dans le passé et le présent de l’Amérique latine, les civils qui assuraient la sécurité de leurs communautés ont mené à des milices de sécurité extrajudiciaire qui ont conduit à des lynchages, des disparitions, des persécutions fondées sur le genre et d’autres formes de violence.
En réfléchissant à la réalité sur le terrain dans les campamentos de Santiago, j’envisage un monde où la méfiance envers la différence et les autres se manifestera à tous les niveaux : les États contrôlant l’entrée sur les territoires qu’ils protègent ; les policiers patrouillant dans les rues ; les commerçants filmant leurs clients ; les civils surveillant leurs quartiers.
PEUR OU LIBERTÉ
La liberté sera sacrifiée au profit de la sécurité, de la surveillance et de la suspicion envers « les autres ». Dans ce monde, l’anxiété pourrait pousser n’importe qui à devenir justicier. Comme l’a écrit le sociologue britannique Zygmunt Bauman, la liberté et la sécurité sont deux biens tout aussi nécessaires dans nos vies, mais il n’est pas facile de trouver un équilibre entre les deux. Pour Bauman, les liens communautaires traditionnels des gens sont rompus par la mondialisation, l’augmentation des inégalités et les déplacements de population, pour laisser place à des affiliations fragiles et éphémères. Ces « déstabilisations » provoquent « la lente expansion de la peur, de l’anxiété et de la surveillance, même dans les espaces les plus intimes, alors qu’un sentiment de danger s’installe dans le monde et dans les foyers », comme l’explique le chercheur Ash Amin.
Écoutez l’auteur, « Une élection vénézuélienne… au Chili».
C’est du moins ainsi que j’ai interprété un rêve que j’ai fait après avoir été interrogé par le voisin de Marta. Je marchais dans une rue bordée de tôles de zinc et de matériaux souples comme des presse-papiers et du plastique, une rue du campamento. Le ciel du quartier était autrefois magnifique, d’un bleu infini et réconfortant. Mais dans le monde de ce rêve, des drones bourdonnants remplissaient l’air. Ils effrayaient même les oiseaux.
Les caméras de surveillance dans un endroit qui commence tout juste à être construit sont une esthétique dissonante. Beaucoup de ces caméras ne transmettaient même pas d’images en raison d’une mauvaise connexion Internet ou d’un manque d’endroit où envoyer le signal.
On pourrait penser que d’autres choses seraient prioritaires dans un endroit sans eau courante, avec des rues non pavées et un approvisionnement électrique intermittent. C’est comme si la peur, le doute et la prudence primaient sur tout le reste. La surveillance devient le seul moyen de communiquer avec les étrangers—même dans les quartiers construits par des personnes également considérées comme des étrangers.